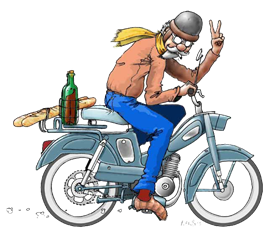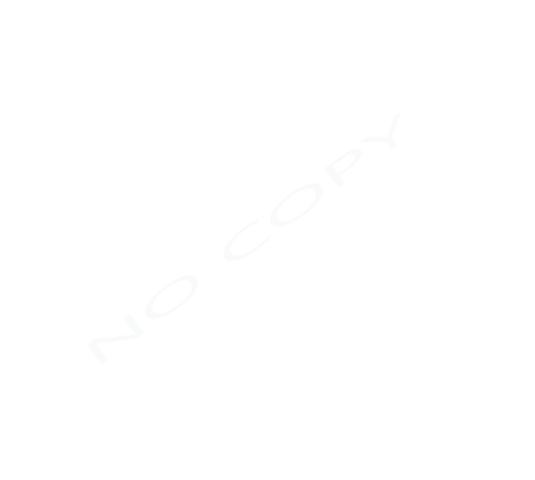
@ Digitt_All - 2021 - pour le Evreux Mob'Tour ©
La Chronique à Maomao.
D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours imaginé qu’enfourcher un deux roues était une expérience ultime, le début d’un voyage dont on ne revient pas, même lorsque l’on remet pied à terre.
Il y a dans un deux roues, l’idée entêtante de la nécessité d’avancer, comme une sommation au voyage, une irrépressible envie d’aller de l’avant car si vous vous arrêtez, vous tombez.
L’équilibre ne vient que par le mouvement. Sans mouvement, vous êtes juste un con à côté d’un vélo ou d’une moto mais sitôt que vous grimpez sur votre engin et que vous avancez, vous vous transformez, vous empoignez votre casque et votre blouson et vous êtes libre, affranchi, voyageur… un explorateur ou un conquérant…
C’est ainsi, la première liberté a souvent la couleur de son premier vélo.
Le mien était « de course », rouge, son guidon « cintre » et son double levier de vitesse fixé sur le cadre.
Quelques années plus tard, dans un matin glacial d’un petit village du centre-var, mon grand-père Louis m’a offert ma première mobylette et j’ai senti pour la première fois, cette sensation unique, celle que nous prodigue quand il fouette notre visage, le vent de la liberté.
C’était un 103 Peugeot orange, récupéré dans une décharge et que « papi Louis » avait retapé lui-même. Rien d’ultime donc et pourtant je crois que j’ai posé sur cette mobylette un des regards les plus exaltés de ma vie, puisque je devinais en l’empoignant ce que cet engin allait faire, c’est à dire mon bonheur et une partie de mon émancipation.
J’y ai passé des heures et quelques « Francs de l’époque » à changer le pot d’échappement (cobra), le guidon (torsadé), le carbu (dellorto), à rouler sans savoir où j’allais, à « cambaler » frangine, copains et copines, à me perdre, à faire angoisser ma mère, à me geler, à tomber en panne d’essence et à « serrer » un jour triste où le 103 a finalement rendu son âme cylindrique.
Après le 103 vint la première moto, puis le permis, puis une seconde, puis une troisième et finalement, à bientôt 67ans, je n’ai jamais cessé d’enfourcher des deux roues, ni d’épouser la philosophie qui les accompagne.
Car on ne devient pas mobeur ou motard impunément, c’est un choix, un choix qui structure notre rapport à l’espace, au temps, à la vitesse, à la météo, au virage, un choix qui influence notre rapport à la route, notre rapport aux autres usagers, notre rapport au risque et même notre rapport à la mort...
Quand je parle de motard ou de mobeur, je n’y inclus pas la pratique urbaine. Se déplacer en mobylette ou en moto dans une ville est souvent pratique et rapide, mais c’est une utilisation contre-nature de la moto-mobylette car dénuée du sens et du plaisir motards, ceux qui se fondent sur l’exploration. De la même manière, emprunter l’autoroute en moto est d’un ennui et d’un inconfort insupportables, sauf à rechercher la vitesse de pointe, ce qui, selon moi, s’inscrit souvent dans une utilisation immature et impropre de la moto sur route.
Ainsi, même si enfourcher une moto-mobylette, c’est évidemment goûter à une accélération qui n’existe quasiment sur aucun autre véhicule, c’est d’abord et avant tout un apprentissage, celui du virage et de la recherche toujours renouvelée de la meilleure façon d’attaquer une courbe, de se pencher et d’enrouler les lacets comme on les dessinerait au pinceau, de chercher et trouver cet angle où l’on a la sensation de survoler la route, suspendu juste trente centimètres au-dessus d’elle, en déséquilibre parfait, arrimé au bitume, en pleine possession de la gravité. Cette sensation-là, née de l’opposition entre deux forces (centrifuge et centripète) agit comme une drogue qui pousse à rechercher partout ces routes sinueuses où les virages s’enchaînent dans des paysages étourdissants. Plus ça tourne et plus le voyage ressemble à une danse où les courbes sont des rondes, douces et enivrantes, comme une valse où les pointes des pieds posées sur les cale-pieds, les cuisses enserrant le réservoir, les mains arrimées au guidon, emportés par ce roulis, nous tournons dans cette spirale sans fin, comme des derviches tourneurs casqués.
La quête du virage est inséparable du bon usage de la moto-mobylette car c’est là, couché en apesanteur, que le motard-mobeur fait son pied de nez à toute autre forme de déplacement. C’est pour cette raison, et pour nourrir cette quête que les motards-mobeurs recherchent la sinuosité qui les entraine sur les terrains les plus reculés. En plus de la route, une relation singulière se noue avec l’air. Là encore, cette relation n’existe avec aucun autre moyen de locomotion, et il se caractérise par la capacité de l’air à donner corps à la vitesse mais aussi à vous laisser en prise directe avec les paysages traversés, leurs panoramas, leurs reliefs et surtout leurs odeurs, celles des forêts, des maquis ou de l’iode, celle de l’asphalte brûlante au mois d’août soudainement rafraîchie par un sous-bois qui vous sert de climatiseur. C’est enfin par ces chemins que la moto-mobylette vous conduit non pas seulement vers un autre monde mais aussi et surtout vers d’autres gens. Il faut lire Robert M. Pirsig: « Ces routes là ne ressemblent absolument pas aux grands axes. Tout y est différent: Le rythme de la vie, la personnalité des gens qu’on y rencontre. Ces gens ne vont nulle part, ils ont le temps d’être courtois. Ils connaissent la réalité des choses. Ce sont les autres, ceux qui sont partis il y a des années vers les grandes villes et leurs enfants perdus, ce sont eux qui sont coupés du sens de la vie. » Les marins ont Moitessier et sa « Grande Route », les motards ont Pirsig et son « Traité du zen et de l’entretien des motocyclettes. »
Car entrer dans la communauté des motards-mobeurs c’est aussi y explorer sa culture, les différentes motos, les moteurs, les marques et leurs spécificités, leurs sonorités, leurs vibrations toujours différentes, et la mythologie qui les accompagne. La culture motarde est faite de ces modèles qui peuplent le cinéma, de la « Captain America » pilotée par Peter Fonda dans « Easy Rider » à la 6T Thunderbird de Marlon Brando dans « L’équipée sauvage », en passant par la Triumph TR6R de Steve McQueen dans « la grande évasion », et des musiques qui les accompagnent de ZZ Top à Lynyrd Skynyrd, d’ACDC à Steppenwolf ou de Creedance Clearwater Revival à Led Zep… il est impossible de rouler durablement sans ajouter le son du Rock, indissociable de la route et de la rythmique du voyage.
C’est ainsi qu’à force de rouler, pour le simple plaisir d’enrouler les virages, et avec un peu de recul sur les rites et les mythes qui entourent la pratique motarde, on comprend un jour que la moto- mobylette n’est pas un simple moyen de locomotion ou un loisir de plus, mais qu’elle repose sur trois principes majeurs, un principe de liberté, un principe de responsabilité et un principe de solidarité.
De liberté puisque le premier effet du deux roues, c’est d’abord de lever des contraintes en permettant d’élargir notre périmètre de mobilité, de pouvoir passer presque partout, de se sentir presque totalement libre, « presque » oui, car c’est lorsqu’on oublie ce « presque » que la réalité nous rattrape brutalement, à un croisement, dans une courbe un peu serrée, en remontant une file, et qu’on se souvient trop tard que le motard-mobeur n’est presque pas protégé… et que la chute est presque toujours dangereuse. Je crois que passé un certain nombre de kilomètres et d’années, tous les motards-mobeurs roulent avec cette appréhension permanente du risque. C’est en cela que la responsabilité est plus grande derrière un guidon que derrière un volant, parce que le droit à l’erreur ne coute pas du tout le même prix. Il y a dans chaque motard un enfant qui guette la prochaine courbe pour faire frotter les cale-pieds contre l’asphalte, et un vieux sage qui vous répète sans cesse de faire attention à vous, à la chaussée, mais surtout à l’autre. Le jour où l’on n’entend plus cette voix, c’est que l’on est vraiment sage ou que l’on est vraiment mort. J’ai toujours pensé que le risque était le prix à payer pour la liberté, et finalement, la moto en témoigne parfaitement.
C’est probablement d’abord parce que chaque motard-mobeur est pleinement conscient du risque qu’il prend à chaque fois qu’il appuie avec son pied gauche sur le sélecteur de vitesse, que les motards-mobeurs forment une communauté d’entraide permanente. Dans un monde où l’individualisme rime souvent, trop souvent, avec égoïsme, la moto-mobylette, qui est une activité individuelle, démontre que l’on peut tout à la fois demeurer autonome sans s’extraire du groupe, y partager les mêmes valeurs et compter sur une solidarité presque sans faille. Ainsi, un motard-mobeur arrêté au bord d’une route ne le reste jamais longtemps. Il y a toujours un autre motard-mobeur pour s’arrêter et lui proposer son aide.
Personne ne nous l’apprend, c’est ainsi et c’est probablement contenu dans ces codes non écrits, ces rites non appris par lesquels on sait où l’on est et qui l’on est.
C’est probablement par cette même intuition communautaire que lorsque deux motards se croisent, ils se font un geste. Ce sont souvent deux doigts de la main gauche qui se tendent, ou le pied droit qui descend de son cale-pied lors d’un dépassement. Pourtant deux motards qui se croisent ne se sont probablement jamais vus et ne se reverront certainement plus jamais, alors à quoi ce geste sert-il et d’où vient-il ? Certains l’attribuent à Barry Sheene qui arborait ce V durant ses tours d’honneur à chacune de ces victoires… d’autres disent qu’il a toujours existé et qu’il est un signal entre deux motards pour indiquer que « tout va bien », et qu’on n’a pas besoin de l’aide de l’autre. Le fait est que ce geste n’a aucune utilité, il ne répond à aucune obligation et n’est enseigné dans aucune moto-école… Il est un signe de reconnaissance entre des gens qui ne se connaissent pas mais qui se disent, « je te vois, je te reconnais, tout va bien. » C’est le principe même de ce que forment les motards-mobeurs quand ils enfourchent leurs engins, une communauté basée sur des valeurs, des rites, des mythes et le désir de les partager. J’y vois un signe de civilisation, de solidarité et même de fraternité. J’y vois la preuve que même séparés les uns des autres, étrangers les uns pour les autres, nous savons encore nous regarder, nous respecter et nous aider les uns les autres.
La moto est une promesse, celle de l’éternel passager clandestin qui se cache en nous, un enfant exalté et heureux, voyageur imaginaire en quête de sa liberté, un enfant qui veut continuer de jouer, de rouler, de rencontrer, de vivre. Cette promesse, sa promesse, c’est celle du voyage, celle d’un long voyage, infini, à la découverte d’un monde dont on voudrait explorer tous les virages, parcourir toutes les forêts, contempler tous les paysages, caresser tous les crépuscules, sentir tous les parfums, un voyage dans le monde et un voyage en soi, indispensable, enivrant et finalement inutile puisqu’à l’arrivée, quand on repose le pied à terre et que l’on retire son casque, on se rend compte que ce que l’on cherche est monté avec nous sur la selle de la moto et que nous l’avons fait voyager tout ce temps, pour le poser là où nous sommes arrivés. Il n’y a pas de destination, il n’y a que le voyage. C’est l’histoire de nos vies, la quête de ce que nous cherchons sans cesse, partout, loin, si loin, et qui est là, en nous: « Je me suis demandé pourquoi nous avons mis si longtemps à comprendre. La vérité était là sous nos yeux, et nous étions incapables de la voir… La vérité frappe à la porte, et on lui dit: « Va-t-en, je cherche la vérité. » Elle, pour le coup, elle s’en va. » ...
Robert M. Pirsig